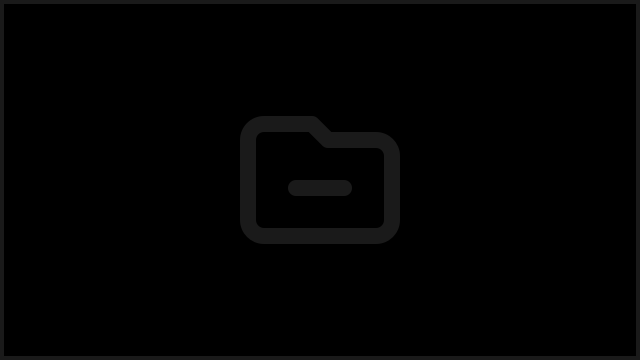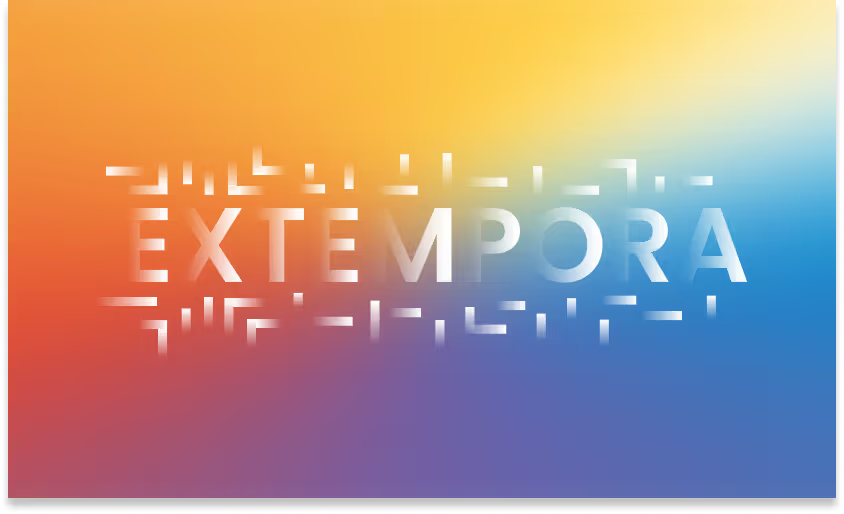Quand les cannes brûlaient : Danse des coupeuses de cannes à la Martinique, Canboulay à Trinidad
Les rituels et festivals liés au travail de la canne à sucre furent longtemps emblématiques des sociétés esclavagistes à économie sucrière de la Caraïbe. Certains se cristallisèrent autour des Cannes Brûlées.
Cette pratique agricole fut tout d'abord adoptée par les planteurs, détournée en outil de rébellion par les esclaves, puis transformée en mascarade carnavalesque par les uns et les autres. Le cas le plus notable est le Canboulay de Trinidad dont le nom découle directement de l'expression Cannes Brûlées. Un autre cas, apparemment plus anecdotique, est La Danse des coupeuses de cannes de la Martinique [1].
La référence à un incendie de champs de cannes à sucre dans l'ancienne chanson des Coupeuses de cannes, recueillie en 1935, à Fort-de-France, par un administrateur français, est pourtant très explicite [2].
Désiré, ola ou té ié...
Désiré, olà ou té ié...
Désiré, olà ou té ié
Quand can-nes à blanc là brûlé?
Quand can-nes à blanc là brûlé,
Bication là passé en feu
Désiré, où étais-tu…
Quand les cannes du blanc ont brûlé
Quand les cannes du blanc ont brûlé
le feu a détruit l'habitation.
Ancienne chanson des Coupeuses de Cannes
À la Martinique comme à Trinidad, on mettait le feu aux cannes pour en faciliter la coupe et la récolte et chasser les bêtes nuisibles des champs. Le feu pouvait aussi se déclarer de façon accidentelle. L'in cendie qui détruisit l'habitation où Désiré travaillait était sans aucun doute d'origine criminelle, autre couse bien connue, quoique souvent tue, desincendies d'habitation.
La Danse des coupeuses de cannes à la Martinique ne semble cependant pas avoir pris la forme du Canboulay à Trinidad, c'est à dire d'une procession nocturne des ateliers d'esclaves menés aux champs incendiés pour en éteindre le feu.
Au delà des Connes Brûlées, La Danse des coupeuses de cannes et le Canboulay offrent l'occasion de foire retour sur les liens historiques qui unirent la Martinique et Trinidad à partir de la fin du dix-huitième siècle, période de l'essor des carnavals de la Caraïbe. L'étude comparée des deux mascara des permet aussi d'identifier quelques unes des caractéristiques des carnavals caribéens de tradition créole française dont ces deux pays furent tour à tour les principaux représentants[4]
La première partie de cette étude consacrée aux premières mascarades de la Martinique et de Trinidad sera consacrée à l'exposé et à l'analyse des représentations carnavalesques de l'esclavage avant et après l'abolition, représentations que le Canboulay et la Danse des coupeuses de cannes, mois aussi d'autres mascarades trinidadiennes et martiniquaises liées à la culture de la conne à sucre, contribuèrent à former sur des modes à peu près équivalents.
Avant d'aller plus loin, il convient de faire remarquer que si le carnaval créole français se développa tout d'abord à la Martinique, à Saint-Pierre notamment, avant de s'épanouir à Trinidad, ce sont sou vent les sources trinidadiennes mieux connues et étudiées, qui permettront d'éclairer les sources martiniquaises, dons un chassé-croisé de textes et photographies des dix-neuvième et vingtième siècles.
1. Représentations carnavalesques de l'esclavage
Martinique
Le peuple se raille de ses anciennes corvées : Congos, Néguelas et Négrelats à Saint-Pierre après l'abolition de l'esclavage
Ferdinand Yang-Ting situe ses souvenirs dans «la période d'après l'abolition de l'esclavage» ; Sala
vina se remémore les Mardis Gras des années 1870-1902 ; et Lafcadio Hearn décrit un Mercredi des Cendres de la fin des années 1880. L'avocat devenu exportateur de Cacao et l'ancien instituteur, tous deux rescapés de l'éruption de la Montagne Pelée, croisent des individus déguisés que le premier appelle Néguelas et le second Négrelats5. L'homme de lettres et grand voyageur américain d'origine hellène, simple passant puis «revenant» de Saint-Pierre, s'arrête, lui, pour regarder ceux que la po pulation a dû lui désigner sous le nom de Congo/'. Leurs champs d'action sont «les rues» pour Yang Ting, «la Grande-Rue» et «le Marché» pour Solavina. Hearn ne le mentionne pas. A n'en pas douter, Néguelas, Négrelats et Congos empruntaient le chemin traditionnel du défilé du Carnaval de Saint-Pierre, du Quartier du Fort à celui du Mouillage en passant par la Rue Bertin, après avoir pris rendez-vous à la Batterie d'Estnoz. Selon Salavino, ils «dansent la bamboula» «au bruit du tom tom saccadé» «bidi bip! bidi bip blipl panpan, pan» alors que pour Yang-Ting «ils défil[ent]», et que pour Hearn «ils vont pied nus». Difficile de se représenter une quelconque danse à partir de ces maigres informations, la première description n'étant rien moins que stéréotypée, et les deux autres invalidant l'idée de danse dont ils ne font pas mention, ni d'ailleurs d'un éventuel accompagnement musical. Pour Yang-Ting comme pour Hearn, le bleu est la couleur des hommes : ils sont «vêtus de bleu» selon le premier et portent «un pantalon d'étoffe bleue» selon le second; et le coutelas, «en bois», précise Yang-Ting, est leur attribut principal. Hearn ajoute que ceux-ci portent un «chapeau bacoué», une «chemise grise d'une étoffe grossière», un «grand mouchoir qui attache la veste», et qu'ils sont pieds nus. Hearn précise par ailleurs que les femmes ont une houe et Yang-Ting que les hommes ont «chacun à la main
une canne à sucre». Yang-Ting et Hearn diffèrent par contre sur le costume féminin, Hearn le décrivant
comme étant de la même facture grossière que le costume masculin, composé d'un «monstrueux cha peau de paille», d'une «chemise de calicot gris», d'un «grossier jupon de percale», de «deux grossiers mouchoirs fotas» et de «gros souliers du pays», quand il comporte des chaussures. Yang-Ting, lui, se souvient de femmes «constellées de bijoux», portant des «jupes d'étoffes riches». Le carnaval aurait-il troqué les vieilles hardes de la représentation mimétique pour les étoffes plus précieuses de la création artistique? Ou les classes sociales pauvres et riches se seraient-elles côtoyées à l'occasion du Carnaval ? Nous reviendrons sur ce point.
Les descriptions de Yang-Ting, Salavina et Hearn permettent de dégager les caractéristiques principales de la mascarade qui, tout d'abord mixte devint par la suite plutôt féminine, et plus tard connue sous le nom de La Danse des coupeuses de cannes. Les attributs essentiels de ses participant(e)s sont le coute las, la houe et la canne à sucre, instruments et produit de la culture sucrière, et son thème fondamental, la représentation, souvent satirique, de l'esclavage, ou plutôt du travail servile pendant la période de l'esclavage. «C'était l'époque voisine de l'esclavage et le peuple se raillait de ses anciennes corvées» écrit en effet Yang-Ting à propos des Néguelas.
Un costume du pays: Le Nègre Gros Sirop à Saint-Pierre en 1887 et à Fort-de-France en 1935
À ces caractéristiques fondamentales des Coupeurs et Coupeuses de connes se superpose parfois celle d'un outre masque bien distinct: l'enduit de couleur noire du Nègre Gros Sirop. Cette mixture noire, couvrant souvent le corps entier, nu si ce n'est «une toile autour des reins» selon Hearn, était généralement constituée «d'un atroce mélange de noir de fumée et de sirop» toujours selon ce dernier qui tient ce masque qu'il nomme «ti nègre gouos sirop» comme faisant partie, à l'instar du Congo, des «quelques costumes du pays». Les outres caractéristiques du Nègre Gros Sirop sont sa bouche rougetite oucou, la conque de lmbi qui annonce habituellement sa venue, et parfois aussi la gesuelle sxuelle. «Avec du roucou ils se rougissent la bouche, qui est comme une tache sanglante, la longue qu'ils ne cess tire, et, munis d'un simple cache-sexe, exécutent une danse faite de gestes et de mouvements obsnes où ils vont jusqu'à mimer l'acte de la reproduction» rapporte Labrousse en 1935, à une époue où, toujours selon ce même auteur, le gros sirop avait été remplacé par legoudron, ce qui valut ou masque l'appellation alternative de Masque à Goudron.